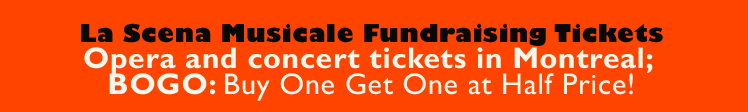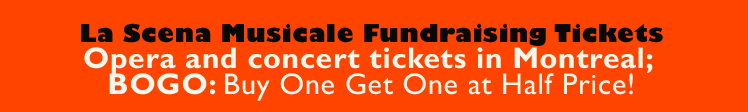SERGEI RACHMANINOV Par Stéphane Villemin
/ 1 mars 2001
English Version...
Le pianiste des pianistes
Extrait du livre
Les grands pianistes, Georg Éditeur, 1999.
De quel Serge Rachmaninov
parlez-vous? Du pianiste, du chef d’orchestre, du compositeur ou de
l’éditeur? » S’il exerça tous ces métiers pendant sa vie, son
professionnalisme lui dicta toutefois de ne pas mélanger les genres. Rachmaninov
savait se muer en une autre personne lorsqu’il passait du compositeur à
l’interprète, mais il détestait faire les deux à la fois. […] Rachmaninov était
un caméléon de la musique et s’investissait toujours au maximum de ses moyens
dans l’entreprise qu’il s’était assignée. […]
En privé, il se révélait très différent de ce qu’il était sur scène. Il
aimait passer de grandes soirées avec ses amis à discuter, jouer au poker ou
faire de la musique. […] Mais avant un récital de piano, Rachmaninov changeait
radicalement, revêtant un autre masque. […]
Les entrées de Rachmaninov sur scène étaient légendaires. L’homme à la
stature élancée et à la coiffure militairement rasée s’avançait avec une allure
impériale jusqu’à son piano. Après avoir salué gravement sans l’esquisse d’un
sourire, ses grandes mains se posaient délicatement sur le clavier. Le fait le
plus frappant, à l’écoute des premières mesures, était sans aucun doute
l’équilibre sonore entre ses deux mains. Rachmaninov semblait différent des
autres pianistes sur ce point car il possédait une main gauche idéale: souple,
rythmée, capable de chanter et de créer des sonorités divines. C’était une main
gauche à l’égal de sa main droite, mais elle paraissait encore supérieure tant
on n’était pas habitué à en voir de pareilles, sauf peut-être chez Godowsky.
Tout en jouant, sa concentration ne faiblissait pas, au point que sa sévérité
apparente n’en était que plus patente. Ne laissant rien transparaître sur son
visage et gardant le buste droit, il semblait vouloir conserver une distance
minimale avec son instrument. Le rubato exagéré et le lyrisme théâtral ne
faisaient pas partie de sa panoplie. Son fluide agissait en réalité d’une autre
manière, et dès les premières secondes, il se passait quelque chose de
saisissant qui captivait et séduisait les auditeurs. Cette alchimie entre un
pianiste et son public est toujours délicate à exprimer avec des mots.
Rachmaninov possédait un sens très profond de la mélodie et sa manière de créer
le rythme demeura inégalée. Il y avait beaucoup de vie, d’énergie et de force
apollinienne dans son jeu. Il était un architecte capable de travailler
simultanément sur plusieurs plans sonores. Être compositeur-interprète
prédispose à certaines qualités que l’artiste analysa lui-même: « J’estime
personnellement qu’un interprète, tout en étant un excellent musicien, ne peut
jamais atteindre la profondeur de sentiment d’un compositeur, ni développer la
gamme des couleurs musicales comme le fait le créateur, car ceci est vraiment
une capacité due au talent de compositeur. » Grâce à cette faculté,
Rachmaninov possédait une vision d’ensemble de l’œuvre qu’il interprétait,
fut-elle d’un autre compositeur. […]
Rachmaninov envoûtait son public sans aucune démonstration apparente, mais le
résultat n’en était que plus saisissant. Les gens se déplaçaient pour écouter
Rachmaninov sans se soucier des œuvres au programme de ses récitals. Dans
Beethoven, Chopin, Schumann ou ses propres compositions, son fluide agissait
avec autant de force. […]
Rachmaninov fut pourtant victime de son succès. Son Concerto pour piano et
son Prélude en ut dièse mineur étaient réclamés à tous ses concerts. Sans
compter qu’Alexandre Siloti et Josef Hofmann les inscrivaient régulièrement à
leurs programmes, il y eut dans la première moitié de ce siècle une déferlante
Rachmaninov qui s’abattit sur l’Occident, de Moscou jusqu’à Los Angeles. On
parlait du fameux musicien russe sous l’appelation de « Monsieur ut dièse
mineur » et l’on se précipitait dans les salles de concerts pour aller
écouter « La Chose », comme l’avait appelée Ernest Newman. […]
Admiré de ses pairs, Rachmaninov fut le pianiste des pianistes, fait
rarissime dans la profession. Cette reconnaissance était le fait de sa sincérité
et de son dévouement à la cause musicale. Il parlait de lui avec humilité, trop
conscient de l’ampleur du devoir à accomplir. « Je ne suis vraiment
moi-même que dans la musique. La musique suffit à une vie entière. Mais une vie
entière ne suffit pas à la musique. » n
1, 2, 3… hourra!
Lucie Renaud
L’Orchestre Métropolitain
fêtera ses 20 ans en grande pompe lors d’un concert spécial qui, le
26 mars, réunira les trois premiers concertos de Rachmaninov. Angela Cheng,
Richard Raymond et André Laplante, qui ont tous fourbi leurs armes avec
l’Orchestre à un moment ou un autre sauront distiller romantisme et virtuosité
en un cocktail explosif de prouesses techniques et de thèmes lancinants. La
Scena Musicale a rejoint les trois interprètes, qui ont bien voulu partager les
secrets musicaux de « leur » Rach.
La galanterie permettra d’entendre d’abord Angela Cheng dans le Premier
Concerto. Il lui a semblé tout naturel d’accepter de participer à cet événement
unique. Après deux tournées avec l’Orchestre Métropolitain, elle a presque
l’impression de faire partie de la famille. « J’ai étudié avec plusieurs
membres de l’Orchestre, j’ai donné des récitals de musique de chambre avec
d’autres, ce sera un réel plaisir de célébrer cet anniversaire avec eux »,
mentionne-t-elle. Œuvre de jeunesse qui porte le numéro opus 1 (première version
en 1891, révision en 1917, à l’époque du Troisième Concerto), le Premier
Concerto fait partie du répertoire d’Angela depuis l’adolescence. Son
interprétation s’est bien sûr transformée au fil des ans. « Chaque fois,
c’est nouveau, souligne-t-elle, car l’interprète bâtit sur ses expériences
passées, joyeuses ou tristes. Je le vois maintenant comme un tout plutôt que
d’être ennuyée par des petits détails techniques, comme j’aurais pu l’être dans
ma jeunesse. » Ce concerto occupe une place particulière dans le cœur de la
pianiste: « C’est mon concerto préféré parce que c’est celui qui m’habite
maintenant. La musique est très romantique, expansive et demande une émotion
profonde. Le dernier mouvement est complexe rythmiquement et me fait penser au
Troisième, avec sa cadence très longue, mais il est important de dépasser cette
difficulté », conclura-t-elle.
La lourde tâche d’interpréter le plus connu des concertos de Rachmaninov
incombera à Richard Raymond. Écrit en 1900 et 1901, le Deuxième
Concerto fut dédié au Dr Nikolay Dahl, un psychiatre qui avait suivi Rachmaninov
quelque temps pour lui redonner le goût de la composition. Dès la première à
Moscou en novembre 1901, avec le compositeur au piano, l’œuvre fut reçue
avec grand enthousiasme. Richard Raymond a sauté sur l’occasion de renouveler
ses liens avec l’Orchestre (avec lequel il avait créé le Concerto de Denis
Gougeon au Festival de Lanaudière). « Cette juxtaposition de concertos
permettra de saisir l’évolution du style du compositeur d’une œuvre à
l’autre. » Il précise qu’il ne cherchera pas à « faire
différent » à tout prix. « Chaque pianiste apporte sa touche naturelle
à ce concerto. Le Deuxième reste très exigeant pianistiquement. À travers les
millions de notes de l’écriture virtuose, une grande sensibilité se dégage. Pour
moi, il sera important de réaliser une recréation du concerto. Une nouvelle
perspective doit être trouvée, qui saura conserver la fraîcheur de
l’œuvre », insiste-t-il.
« L’Everest des pianistes », « Le Rach 3 », sera défendu
par André Laplante. Complété en 1909 dans le but de promouvoir sa carrière
américaine de concertiste, le Troisième Concerto est dédié à un autre très grand
pianiste, Josef Hofmann, qui n’osa jamais le jouer en public. La première en fut
donnée le 28 novembre 1909 avec Rachmaninoff au piano, à New York. Le
16 janvier 1910, il l’interprétera de nouveau, cette fois au Carnegie Hall
avec l’Orchestre philharmonique de New York sous la baguette de Gustav Mahler.
André Laplante est un habitué du concerto: « Parmi les 47 concertos de mon
répertoire, c’est une œuvre que j’aime particulièrement et que j’ai souvent eu
l’occasion d’interpréter partout dans le monde avec plusieurs orchestres
différents, se souvient-il. Le concept que j’ai de l’œuvre est très clair, les
problèmes pianistiques ont été maîtrisés, ce qui me permettra d’ajouter un peu
d’improvisation dans ce que je ferai. C’est un concerto qui prend du temps à
digérer parce qu’il faut l’approcher musicalement. J’aspire à une grande liberté
qui aidera la technique. Après tout, la technique, ce n’est pas de jouer plus
vite et plus fort mais d’entendre ce qu’on veut faire et d’être capable de
l’appliquer. Il faut savoir se concentrer sur les choses essentielles, par
exemple jouer avec tout le corps et comprendre où l’énergie disparaît. »
Sans aucun doute sera-t-elle perçue en triple par le public qui se sera déplacé
ce soir-là…
English Version... |
|