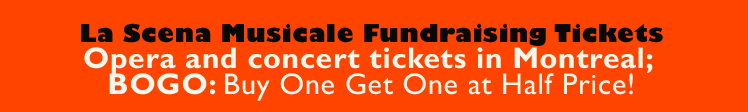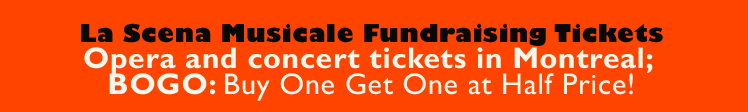Version Flash ici.
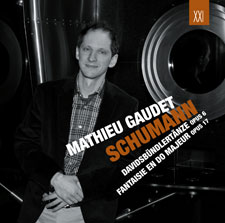 Mathieu Gaudet, poète
du piano, est un homme de philosophie et d’action. Ressentant le besoin
d’être nourri en tant qu’être humain, il s’implique avec une
grande intensité dans toutes les sphères de sa vie, de sa pratique
de la médecine à sa vie familiale. La pratique du piano lui permet
de se retrouver seul avec lui-même. Ce mois-ci, LSM et les productions
XXI sont donc particulièrement heureuses de vous plonger, en sa compagnie,
dans l’univers intimiste et sensible de la musique de piano de Robert
Schumann. La musique de ce grand romantique sied à Gaudet, lui parle:
l’environnement de Schumann, ses références littéraires, ses personnages
romanesques le fascinent depuis longtemps. Schumann est pour lui un
grand coup de cœur, son second après Bach!
Mathieu Gaudet, poète
du piano, est un homme de philosophie et d’action. Ressentant le besoin
d’être nourri en tant qu’être humain, il s’implique avec une
grande intensité dans toutes les sphères de sa vie, de sa pratique
de la médecine à sa vie familiale. La pratique du piano lui permet
de se retrouver seul avec lui-même. Ce mois-ci, LSM et les productions
XXI sont donc particulièrement heureuses de vous plonger, en sa compagnie,
dans l’univers intimiste et sensible de la musique de piano de Robert
Schumann. La musique de ce grand romantique sied à Gaudet, lui parle:
l’environnement de Schumann, ses références littéraires, ses personnages
romanesques le fascinent depuis longtemps. Schumann est pour lui un
grand coup de cœur, son second après Bach!
Tout d’abord au
programme, la version originale des Davidsbündlertänze
(Danses des compagnons de David),
l’opus 6 daté de 1837, véritable monument d’imagination en 18
pièces de caractère. Schumann présente dans cette suite une société
imaginaire (d’inspiration biblique), qui se dévoue à reconnaître
et perpétuer la musique de tradition classique et de ses maîtres.
Il y oppose celle des «Philistins», tenants de la complaisance musicale
et de la virtuosité insipide.
Les personnages qu’il
y met en scène sont nés dans la Neue Zeitschrift für Musik,
un périodique musicologique qu’il a contribué à fonder en 1834
et qui existe toujours aujourd’hui. Schumann y aura rédigé une centaine
d’articles. Les célèbres alter ego de Schumann, Eusebius le contemplatif
et Florestan l’impétueux, s’y expriment dans une dualité singulière.
Nombre de collaborateurs adoptent également des personnages imaginaires,
préparant ainsi un « futur poétique » et posant les jalons de la critique
musicale. Quant aux Davidsbündlertänze, ses miniatures sont
toutes précédées des lettres E ou F dans la première édition, les
initiales des comparses l’ayant signée. Gaudet souligne pour sa part
combien cette forme cyclique rafraîchissante est liée au monde littéraire.
L’œuvre est empreinte de Sehnsucht, de désir intérieur,
surtout dans les dernières pièces. Pleine de quiproquos, elle suggère
parfois même un enfant souriant, en larmes.
C’est peut-être
dans la Fantaisie en do majeur
op. 17 que l’on plonge le plus à fond dans le monde riche et énigmatique
de Schumann. Œuvre phare à grand déploiement et à forme continue,
elle recèle une intensité qui a pu faire dire aux musicologues que
Schumann fut un fou de musique, comme d’autres sont des «fous de
Dieu»1. Elle dépasse le piano, suggère tout un orchestre.
Schumann y exprime son amour passionné pour Clara, sa future épouse.
On y retrouve d’ailleurs le motif d’une quinte descendante, en mouvement
conjoint, en référence aux cinq lettres de son nom. Des digressions,
planantes comme un rêve, altèrent la forme traditionnelle de la sonate.
La lumière la plus pure et l’espoir s’emmêlent à des moments
sombres. Le thème instable, transitif, se démantèle; le rondo franc
du début est rapidement interrompu, l’œuvre regorge de paradoxes
fascinants. Gaudet considère qu’elle est la synthèse de la musique
de Beethoven et de Schumann, celle qui a le plus à offrir.
Gaudet nous laisse
finalement sur la cinquième des variations posthumes, publiées en
1873 en guise d’ajout aux Études symphoniques,
l’un des plus grands cycles de piano de Schumann. Ces pages ont été
sauvées par Brahms lui-même! Jusqu’à la question de leur intégration
aux Études symphoniques soulève les passions des musicologues.
Schumann avait tristement sombré dans la folie en 1854. Il fut
interné à la clinique d’Endenich, où il demeurera jusqu’à sa
mort en juillet 1856, à l’âge de 46 ans.
Interrogé sur
le rôle des concours dans la carrière d’un musicien, Gaudet les
voit comme des occasions d’en apprendre sur soi. Somme toute importantes
et difficiles, ces épreuves excitantes sont des incitations puissantes
au travail, parfois des tremplins internationaux. Gaudet lui-même en
sait quelque chose: il a participé au Concours de musique du Canada
de l’âge de 9 ans jusqu’à 20 ans, aux concours des universités
et des camps d’été en plus d’avoir été demi-finaliste au Concours
international de Montréal en 2004. Il souligne que les concours demandent
la sagesse de ne pas se présenter à moins d’être solidement préparé.
Le pianiste fait la part des choses; on voit les concours venir comme
l’événement d’une vie, mais c’est plutôt l’humilité et le
travail qu’elles enseignent.
Somme toute, plus
le temps a passé, plus la musique a développé chez Gaudet l’art
de vivre, lui a permis de se réapproprier «l’émerveillement des
petites choses». À ceux qui se demandent comment il accomplit tout
cela, il répond: «Avec le bonheur de rester ouvert. Il ne faut pas
s’habituer aux petits miracles de la vie.» Gaudet s’implique également
comme coopérant à l’international et complétera cette année sa
résidence en médecine familiale. Pour lui, chaque humain est unique
et demande qu’on s’y adapte: en musique comme en médecine, passer
de la théorie à la pratique, de l’apprentissage au jeu où la pratique
est un art.
Le 1er décembre,
Mathieu Gaudet se joindra à Pentaèdre et Suzie LeBlanc pour des
Schubertiades toutes viennoises à la salle Tudor d’Ogilvy. Le
concert est offert dans une formule bouchées/vin à 17h, puis chocolats/porto
à 20h. 514-398-4547. Le 20 janvier, il sera à la salle Bourgie pour
présenter un concert autour de l’histoire de la fugue, avec des œuvres
de Schumann, Ana Sokolovic, Feininger et J. S. Bach. Dans le cadre du
festival «Une fugue au Musée» et de la série «Hommage à Ana Sokolovic»
de la SMCQ.
1 B. François-Sappey,
Robert Schumann, Paris, Fayard, 2000, p. 23
English Version...