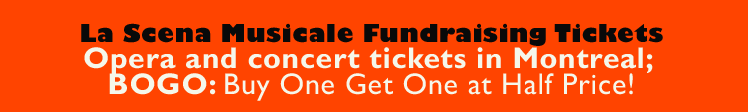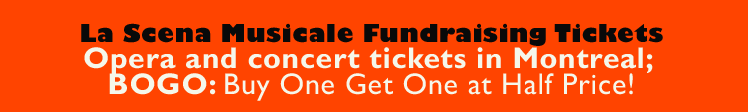Festival Bach / Bach Festival Par/by Thomas Dommange
/ December 12, 2005
Version française...
Les communautés imaginaires de la Passion selon saint
Matthieu
 Introduction Introduction
Le sujet principal de la Passion selon saint Matthieu
pourrait-il ne pas être seulement le récit de la Passion du Christ, mais aussi
une réflexion musicale sur la façon dont un tel récit structure la communauté
qui l'écoutei ? L'œuvre est en effet organisée, à la fois dans son traitement
du récit évangélique et dans l'organisation de ses commentaires théologiques,
de façon à révéler aux fidèles la nature et le sens de l'assemblée qu'ils
forment. Deux arguments peuvent légitimer cette hypothèse. En premier lieu
l'utilisation constante dans l'œuvre de chorals (ces chants traditionnels de la
liturgie protestante) et la présence de deux chœurs placés chacun à un bout de
l'église ; deux chœurs auxquels Bach donne un nom, nous indiquant
vraisemblablement par là sa volonté d'en faire des personnages. En second lieu
le fait que ces chœurs incarnent, par leur dénomination, autant que par la
singularité du traitement musical auquel Bach les soumet, une figure distincte
et imaginaire de la communauté « réelle » formée par le public. Aussi Bach
fait-il entendre séparément, ou dans un dialogue, deux chœurs, désignés
respectivement par les « Filles de Sion » (chœur I) et par les « Croyants »
(chœur II), qu'il réunit lorsqu'il veut faire entendre les chorals. La
communauté réelle – celle par exemple des fidèles assistant à l'audition de la Passion
selon saint Matthieu le 15 avril 1729 – se trouve ainsi « placée »
devant des choeurs qui sont autant d'assemblées fictives symbolisées par des
personnages de l'oeuvre. Pourquoi Bach se livre à une telle démultiplication
des chœurs ? Quel est l'effet visé de ces « images de communauté » sur la
communauté réelle ?
I. Le choral : l'« Idée » de l'assemblée.
À l'évidence, la figure marquant le plus fortement
dans l'œuvre la notion de communauté est celle du choral. Pilier de
l'orthodoxie luthérienne, le choral est ici harmonisé à quatre voix afin de
laisser toujours audibles la mélodie et les paroles, selon les préceptes de
Luther tels qu'il les a consignés dans sa préface au premier recueil de
cantiques de Wittenberg en 1524. En recourant au choral, forme parfaitement
connue par l'assemblée des auditeurs d'alors, Bach tend à cette communauté «
réelle » un miroir dans lequel les fidèles ne peuvent manquer de se
reconnaître. Seulement, l'hypothèse d'une pure et simple coïncidence symbolique
entre l'assemblée réelle et le choral se heurte à la fonction qu'un tel chant
occupe dans la Passion. Si Bach interrompt et commente souvent le récit
évangélique avec des chorals, c'est pour indiquer à l'assemblée la
signification théologique de ce qu'elle entend. Tel est le cas du choral O Lamm
Gottes qui, dès l'ouverture de l'œuvre, expose son sens théologique en
identifiant le Christ à la figure de l'agneau offrant le salut à l'homme en
échange de ses péchés. Mais si la communauté réelle est celle qui doit
apprendre des chorals le sens de la Passion du Christ, elle ne peut aussi
simplement s'identifier à la communauté imaginaire qui les chante.
Une telle différence entre la communauté figurée par
le choral et la communauté réelle est encore amplifiée par le fait que le
choral reste extérieur au déroulement du drame. En effet, le choral, sur le
plan tonal, semble se désengager de l'action menée par le récit, par une
harmonisation sensiblement distincte des morceaux, récitatifs et airs, qui
l'encadrent. Ainsi, au milieu du chœur d'ouverture, l'irruption d'un choral
harmonisé en sol majeur semble trancher sur une trame en mi mineur que se
partagent les deux chœurs en dialogue. Un tel traitement du choral nous fait
voir symboliquement une communauté arrachée à la temporalité de l'histoire,
quand la communauté réelle demeure encore prise dans ses remous. Chanté
fictivement depuis un au-delà de la cité terrestre, le choral ne nous ferait
pas voir le reflet exact de l'assemblée réelle, mais à quoi elle ressemblerait
une fois achevée l'histoire du monde, c'est-à-dire, une fois sauvée. Les
chorals présentent donc à la communauté réelle qui les entend une image dans
laquelle elle est arrachée à son humaine condition, purifiée et sans crainte.
Or dire cela, c'est dire que le choral nous fait voir l'idéal de la communauté
réelle. Non pas exactement ce qu'elle est, mais ce qu'elle a à devenir, ce
qu'elle devrait être si elle était réellement pieuse, si elle était réellement
le corps du Christ ressuscité. Comment la communauté réelle peut-elle atteindre
cet idéal? C'est tout le sens du double chœur que de rendre cet idéal sensible
aux fidèles et de faire en sorte qu'ils se sentent d'ores et déjà réellement
membres de l'assemblée céleste figurée par le choral.
II. Les figures imaginaires de la communauté.
L'ouverture de la Passion suffit à donner une
idée claire du rôle des chœurs I et II dans l'œuvre. Traditionnellement, les
passions responsoriales allemandes, selon le modèle défini vers 1530 par
J. Walter, s'ouvrent par une annonce initiale qui invite les fidèles à écouter
le récit des dernières heures de la vie du Christ. Contrairement à cette
pratique, J.-S. Bach amorce son récit par un dialogue entre deux chœurs qui
convient les fidèles non pas à entendre mais à voir le Christ en
croixii. Dans la suite de l'œuvre, Bach introduit six dialogues entre les
chœurs I et II dont les échanges auront pour enjeu la contemplation de la
Passion du Christ. En effet, quatre de ces six dialogues témoignent
explicitement d'une attitude contemplative. En faisant du regard un objet
récurrent des interventions des chœurs, Bach place donc en marge du drame deux
personnages dont toute l'action consiste à suivre le déroulement de la Passion
du Christ. Ces personnages n'indiquent pas seulement aux spectateurs de ce
tableau qu'il faut regarder le Christ, mais encore qu'il faut les regarder eux
au moment même où ils le contemplent. Les chœurs I et II rendent donc explicite
ce que Luther indiquait déjà dans son Sermon sur la contemplation de la Passion
: à savoir que la Passion du Christ engage une histoire du regard ; que ce
regard doit être éduqué et que de celui-ci dépend en partie notre salut. Avec
ce double chœur, J.-S. Bach invente donc deux personnages, nommés « filles de
Sion » et « Croyants », qui ont pour unique fonction de déployer devant nous le
drame des assemblées spectatrices des souffrances du Christ. Mais pourquoi deux
assemblées pour contempler ainsi le drame et non une seule ? Parce que chacune
d'elle porte un regard singulier sur la Passion. Pour comprendre la nature de
ce double regard, il faut faire rapidement le portrait de chacun de ces deux
chœurs.
« Sion » désigne dans la Bible l'assemblée céleste qui
s'unit au Christ. Cette union finale de Sion avec le Christ – Sion étant
identifiée dans l'Ancien Testament à la Jérusalem céleste – est explicite dans
de nombreux textes de l'Apocalypse ou du Cantique des Cantiques.
Dans la Passion, cette rencontre se manifeste entre autres par
l'utilisation des cordes seules dans l'arioso Et maintenant le Seigneur est mis
au repos (numéro 67) qui regroupe de façon unique dans la Passion
toutes les voix du chœur I. Or, sur le plan de l'orchestration, Bach avait
jusque-là choisi de ne faire entendre les seules cordes et le continuo que pour
accompagner les récitatifs du Christ, abandonnant cette combinaison exclusive
au moment de la mort du Messie (au numéro 61a de l'œuvre). Quand ce type
d'orchestration réapparaît dans l'avant-dernier numéro, on peut supposer que
c'est pour signifier l'identification des Filles de Sion au corps du Christ. La
situation et la dimension théologique du personnage représenté par le chœur I
se retrouve donc finalement très proche de la communauté idéale rencontrée dans
le choral. À la différence qu'au lieu d'être désincarné, réduit au seul rôle de
témoin idéal, ce personnage réagit activement au déroulement de la Passion du
Christ, pleure et s'émeut de ses souffrances. La fonction principale du chœur I
serait de donner à la communauté représentée par le chant choral une
consistance sensible. Les « filles de Sion » seraient cette assemblée du choral
devenue personnage d'un drame ; personnage dont la fonction fait voir à
l'assemblée des fidèles les affects dont elle doit être animée pour atteindre
sa figure idéale. Mais cette communauté, parce qu'elle est celle qui va
nécessairement s'unir au Christ, n'est pas encore à l'image des fidèles. Double
imaginaire de l'assemblée figurée par le choral, elle ne représente pas ceux
qui sont assis dans l'église.
C'est pour les faire entrer dans le drame de la
contemplation qu'il faut nécessairement un deuxième chœur auquel Bach donne en
toute logique le nom de « Croyants ». Ce second chœur qui intervient moins que
l'autre pose de nombreuses questions au premier, affirmant par là sa dépendance
vis à vis de lui. Ainsi, dans le dialogue qui suit la demande de Jésus faite à
ses disciples de veiller avec lui, le chœur II interroge le chœur I : « Quelle
est la cause de tous ces tourments ? » De même, dès l'ouverture de la seconde
partie de l'œuvre, les « Croyants » interrogent : « Où donc ton ami est-il
parti ? » et parvenus au Golgotha, demandent encore vers où ils doivent tourner
leurs regards. C'est dire que si la communauté représentée par le chœur I sait
d'emblée ce qu'il faut contempler dans la Passion, celle qui est figurée par le
chœur II semble au contraire ne pas savoir comment regarder. On ne veut pas
dire par là que le chœur des « Croyants » ne voit pas le drame exposé devant
lui. Ses réactions devant la flagellation du Christ ou la trahison de Judas
témoignent au contraire de l'attention qu'il porte aux événements qui se
déroulent devant lui. Mais alors que pour le chœur I le drame se déploie en
quelque sortedepuis sa fin et toujours dans une perspective théologique, le
chœur II est ce personnage qui réagit au drame dans le présent de sa narration,
et qui, dans sa pitié comme dans sa colère, le contemple comme on regarde une
tragédie dont le Christ serait le héros malheureux. Compris ainsi, le chœur des
« Croyants » est un chœur de « spectateurs ». Il reproduit dans la Passion selon
saint Matthieu, la situation des fidèles de la Thomaskirche, eux
aussi spectateurs du drame que l'œuvre déploie devant eux. Figure d'une
assemblée spectatrice, mais intégrée au drame, le chœur II effectue une mise en
abyme de la situation dans laquelle se trouve la communauté réelle et par là
nous donne à voir sa véritable image.
Or si Bach sépare ainsi deux chœurs, c'est pour mieux
mettre en scène musicalement l'histoire de leur réunion. C'est ce que montre
par exemple l'analyse du chœur d'ouverture dans lequel le personnage des
croyants, chanté par le chœur II, joint peu à peu son chant à celui du chœur I
pour partager sa peine. Si on ne peut ici exposer les étapes de cette fusion
progressive, retenons déjà qu'à travers la jonction de ces deux chœurs, Bach a
peut-être voulu indiquer que, peu à peu, le regard du personnage des « Croyants
» se confond avec celui des « Filles de Sion ». Modifier le regard de cette
assemblée spectatrice, l'amener à être cet œil qui saisit la vérité du drame
qui se joue devant elle, lui faire sentir les errances et les éblouissements de
celui qui contemple la croix en véritable croyant, tel est le projet qui porte
et structure l'œuvre.
III. La communauté défigurée.
Nous avons rencontré dans la Passion quatre
figures de la communauté réelle, enchâssées les unes dans les autres. Aux deux
extrémités de ce jeu d'images, nous avons placé d'une part la communauté
réelle, hors de l'œuvre, et d'autre part, dans l'œuvre mais à la pointe extrême
de tout figuralisme musical, l'assemblée signifiée par le choral. Bien que le
rapport entre les deux soit incontestable, nous avons voulu montrer que ces
communautés sont séparées de toute la distance qui oppose le réel à l'idéal, le
terrestre au céleste. Si le choral représente l'idéal de la communauté réelle,
cet idéal demeure inatteignable. Il faut pour le rendre sensible à l'assemblée
des fidèles la mise en place d'un double chœur. Chacun de ces chœurs, en effet,
les « filles de Sion » d'un côté et le chœur des « Croyants » de l'autre,
semble refléter à l'intérieur du drame l'un le chant choral et l'autre la
communauté réelle spectatrice de l'œuvre. Transportée sur le terrain du drame,
placée fictivement en situation de contempler la Passion du Christ, l'assemblée
issue du choral prend le masque des « Filles de Sion », pendant que l'ensemble
des fidèles prend celui des « Croyants ». Le dialogue entre les deux chœurs
peut alors exposer leur fusion progressive jusqu'au point où le chœur II
confond son regard sur la Passion avec celui du chœur I. Au sein de la fiction
se trouve ainsi exposé et réalisé, de façon métaphorique mais avec toute la
consistance affective de la musique, l'union impossible de l'assemblée choral
et des fidèles, c'est-à-dire l'accès de la communauté réelle à son corps idéal.
De l'articulation musicale et formelle de toutes ces
figures, on pourrait tirer un enseignement sur la façon dont une communauté
construit son identité. Et dire : l'identité d'une communauté ne peut être
réalisée qu'imaginairement. Cela signifie d'abord que l'identité à atteindre
n'existe que comme image ou comme idéal. Une telle situation est similaire à la
nôtre quand nous voulons nous décrire et dire qui nous sommes. En nous livrant
à un tel exercice, nous remarquons que nous parvenons seulement à donner une
image de nous-mêmes. De même, quand la communauté des fidèles veut dire ce
qu'elle est, elle ne parle pas de son corps réel ou effectif, par exemple d'un
corps essentiellement limité dans le temps et dans l'espace de la société
leipzigeoise du début du XVIIIe siècle, mais elle projette dans le choral une
image théologique et purifiée d'elle-même. Par là, on ne veut pas dire qu'une
telle communauté se trompe dans la définition qu'elle donne d'elle-même et,
qu'ignorante de ce qu'elle est, elle s'invente alors une identité imaginaire en
marge de la première. Mais plutôt que la Passion aurait d'abord pour
effet de faire saisir aux fidèles que l'identité de la communauté qu'ils
forment n'est pas une réalité tangible mais une image. La présence du double
chœur au sein de l'œuvre indique en outre – et c'est la seconde raison pour
laquelle l'identité est essentiellement fantasmatique – que cet idéal de soi ne
peut être atteint qu'à travers une fiction. Le paradoxe d'une réalisation de
l'identité possible uniquement dans « l'image » ne vaut peut-être pas que pour
l'assemblée à laquelle Bach s'adresse, mais pour toute communauté occupée à
bâtir son identité. Ne peut-on pas considérer par exemple que c'est dans le
cinéma que les États-Unis construisent la société invincible et omnipotente
qu'ils veulent être ? Et cela parce que l'identité de cette nation, comme des
autres, est essentiellement fantasmatique?*i?
-
Les hypothèses présentées ici proviennent en partie
d'un doctorat de philosophie consacré aux Paradoxes métaphysiques de la Passion
selon saint Matthieu de J.-S. Bach. Ce texte a en outre fait l'objet de
nombreuses relectures et discussions avec Joël Thiffault dont les remarques ont
été précieuses.
-
On rappelle le début du dialogue qui constitue le
chœur d'ouverture :
« Sion : Venez, mes filles, voyez mes
larmes ... Voyez !
Croyants : Qui ?
Sion : ...le fiancé. Voyez-le...
Croyants : Comment ?
Sion : ... tel un agneau.
[...]
Sion : Voyez !
Croyants : Quoi ?
Sion : La douce patience. »
Version française... |
|