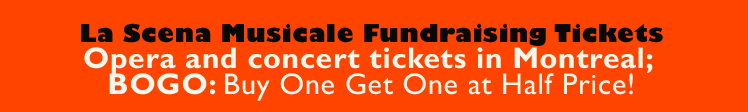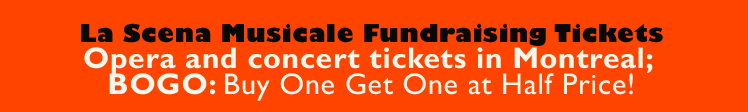Luciano Pavarotti : Il semait la joie Par Norman Lebrecht
/ 3 octobre 2007
English Version...
Il adorait se faire appeler « le ténor
du siècle », puis il protestait aussitôt : « Non, ce n’est pas
moi, c’est Enrico Caruso. » Luciano Pavarotti a toujours vu le grand
Napolitain comme un modèle, tant en technique vocale qu’en raison
de sa soif insatiable de célébrité. Cependant, si Caruso était reconnu
comme une voix sur disque, Pavarotti exploitait chaque kilo de son corps
énorme et tous les trucs du métier pour devenir célèbre uniquement
parce qu’il était Pavarotti.
Des millions de personnes qui n’ont
jamais franchi les portes d’une salle d’opéra ou écouté une chaîne
de musique classique pouvaient reconnaître instantanément le gros
bonhomme souriant à la serviette blanche qui lui servait de mouchoir,
de carré-éponge et d’accessoire de scène.
Il était aussi connu que la princesse
Diana, l’une de ses admiratrices; affligé à ses obsèques il y a
dix ans, il se déclara trop ému pour chanter. Ils ont figuré ensemble
sur un timbre postal commémoratif, inséparables pour toujours. Plus
qu’une simple vedette lui-même, il rehaussait et validait la
célébrité des autres.
Pavarotti était, dans tous les
sens du terme, immense. Il faisait le poids de trois hommes – il atteignait
les 140 kilos – et, même s’il avouait que son gabarit était «
son plus grand regret », c’était aussi son trait distinctif, grâce
auquel on ne pouvait le prendre pour aucun autre chanteur. Il a dansé
sur les pèse-personnes toute sa vie, mais jamais assez pour le ramener
à un poids raisonnable.
Sa corpulence n’a jamais diminué
son charme. Des femmes de tous âges se ruaient vers sa loge et le ténor
cueillait avidement tous les plaisirs qui s’offraient, se vantant
de ses prouesses. Durant les 37 années de son mariage avec Adua, qui
gérait une écurie de chanteurs d’opéra et de chefs, il emmenait
une maîtresse dans presque toutes ses tournées. Il coupa les ponts
en 2003 et épousa Nicoletta Mantovani, une assistante plus jeune que
ses trois filles; Bono et Bocelli ont chanté à leur mariage à Modène.
On ne peut faire plus grandiose.
Dégarnie par son divorce et par
une longue histoire d’évasion fiscale en Italie, réglée en 2001
pour la somme de dix millions d’euros, sa fortune demeurait néanmoins
plus considérable que celle de tout autre chanteur d’opéra de l’histoire,
assurée par des redevances trimestrielles record et par des cachets
d’au moins un million de dollars chaque fois qu’il se produisait
dans un parc public ou un stationnement – ce qu’il fit abondamment
dans la dernière décennie de sa carrière.
Il a vendu, plus de 70 millions
d’albums, le plus grand nombre de disques d’opéra, trois fois plus
en fait que Maria Callas. Pourtant son répertoire était restreint
: 30 opéras, comparativement aux 110 opéras de Placido Domingo; son
expressivité était monolithique et sa crédibilité comme jeune premier
bohème n’avait rien pour lui mériter les palmes de la Royal Academy
of Dramatic Art. Personne ne semblait s’en soucier. Les gens payaient
des centaines de dollars pour entendre Pavarotti, pas Puccini. Il était,
selon la formule du critique allemand Jurgen Kesting, « à la fois le
prototype du ténor d’opéra et sa parodie. »
Jeune garçon à Modène, où il
est né en octobre 1935, il préférait le foot au chant et il était
encore un solide ailier lorsqu’il fit ses débuts dans le rôle de
Rodolfo en Émilie en 1961. C’est à Covent Garden qu’il attira
l’attention. Entendu lors d’une tournée en Irlande, il fut engagé
en 1963 par la régisseuse Joan Ingpen comme remplaçant du fragile
Giuseppe di Stefano et chanta dans chacune des 27 présentations de
La Bohème sauf une, décrochant au passage une apparition à l’émission
Sunday Night At The London Palladium. Malgré sa haute taille, il
était le seul ténor à pouvoir regarder Joan Sutherland droit dans
les yeux et son mari, le chef Richard Bonynge, le prit sous sa protection.
Les Bonynge l’emmenèrent en
tournée en Australie et aux États-Unis, où un brillant publiciste,
Herbert Breslin, le sacra « King of the High Cs ». Il chanta en 1971
au Metropolitan Opera dans la Fille du régiment de Donizetti,
enchaînant neuf contre-ut avec une résonance cristalline. Breslin
devint son imprésario et le Modénais fut bientôt une vedette universellement
connue, entendue sur disque, à la radio, à la télévision. Il a même
survécu au désastre d’une comédie romantique hollywoodienne, Yes
Giorgio, qui ajoutait de la crédibilité au western spaghetti.
Breslin lui reprochait sa paresse. Pavarotti ne s’est jamais vraiment
donné la peine d’apprendre les langues étrangères, convaincu qu’on
lui pardonnerait n’importe quoi, tant et aussi longtemps qu’il décochait
son fameux sourire et qu’il se mettait à chanter.
Domingo, polyglotte et deux fois
plus brillant, étouffait et rageait dans son ombre. Tous deux insistaient
pour dire qu’ils n’étaient pas ennemis, aucun ne ratait une occasion
pour rabaisser son rival. La hache de guerre fut finalement enterrée
lorsque José Carreras, rétabli d’une leucémie, proposa de tenir
le concert des Trois ténors à la Coupe du Monde de 1990 à Rome. Le
disque se vendit à 12 millions d’exemplaires et propulsa Pavarotti
vers un autre sommet de célébrité, loin au-dessus de ses partenaires.
Des prestations racoleuses, la
série de spectacles Pavarotti and Friends à Modène où il a chanté
avec des artistes pop comme Elton John, Liza Minelli et Barry White,
ont terni une réputation déjà endommagée par de fréquentes annulations.
Il lui est même arrivé de se décommander de Covent Garden, « malade
» sur une plage des îles du Sud, entouré de femmes en jupes de feuilles.
Mais pour son public, Pavarotti
demeurait irréprochable et, lorsqu’il daigna revenir à la Royal
Opera House, c’est lui qui, souriant, se montra magnanime. À la suite
de leur rupture, Breslin révéla, sans le ménager, ses lacunes dans
un livre, Le Roi et moi, et Pavarotti continua d’arborer le
même sourire. Comme un cuirassé entouré de bateaux de pêche, il
était intouchable, invulnérable.
Personne ne peut prétendre l’avoir
bien connu, car il n’y a jamais eu grand-chose à approfondir. Il
ouvrait rarement un livre, se montrait peu curieux de la vie ou de l’au-delà,
et sa conversation s’en tenait généralement aux pâtes, au foot,
aux chevaux, aux voitures sport ou aux dernières rumeurs du petit monde
de l’opéra. Il a traversé la vie en toute innocence et son regard
indigné, lorsqu’il fut accusé de supercherie – il a été pris
à mimer en concert ses propres enregistrements – ou d’évasion
fiscale, aurait touché le cœur du juge le plus intraitable.
Pavarotti était plus grand que
nature. Aucun chanteur ne possédait une telle aisance, une telle capacité
de trouver, caché dans ses profondeurs, un son et de le laisser se
matérialiser comme si l’effort humain n’y était pour rien. Plus
jeune, il a été sans égal dans les rôles de bel canto, souvent comme
faire-valoir de Sutherland, remarquable comme Nemorino dans L’elisir
d’amore. Au milieu de sa vie, ses Rodolfo dans La Bohème
et Riccardo dans Ballo in Maschera ont été légendaires, tout
comme son Cavaradossi dans Tosca et son duc dans Rigoletto.
Il avait de la difficulté à lire
la musique et redoutait le Verdi tardif, plus sombre, mais ses enregistrements
du Requiem avec Solti, Muti et Karajan demeureront pour toujours
des trésors de spiritualité. Ses longs adieux ont été troublés
par un cancer du pancréas et les effets accumulés de son obésité.
Et pourtant, malgré ses souffrances, Pavarotti sera mort avec le sourire,
confiant d’avoir ajouté énormément à la somme de la joie humaine
et, comme Sinatra avec qui il a un jour chanté My Way, de l’avoir
fait « à sa manière ».
C’est ce que Pavarotti faisait :
il rendait les gens heureux. n
[Traduction : Alain
Cavenne]
English Version... |
|