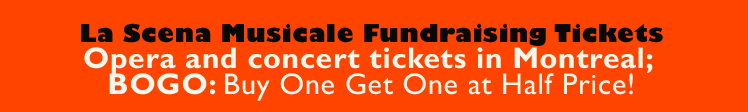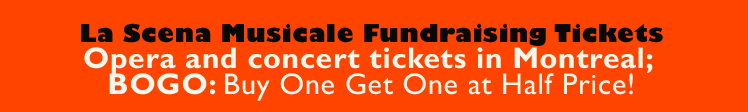Livres Par Réjean Beaucage
/ 14 mai 2005
Deux livres
parus ces derniers mois sauront sans doute captiver les amoureux de la musique
vocale, fussent-ils amateurs ou professionnels. À tour de rôles (Fondation
Jeunesses Musicale du Canada, 438 p., 2004), rédigé par le musicien et
réalisateur radiophonique Jacques Boucher et la musicologue Odile Thibault,
nous permet de suivre l’itinéraire artistique du grand chanteur québécois
Joseph Rouleau. Comprenant une iconographie importante témoignant de toutes les
étapes de la vie de Rouleau, le livre est le fruit d’une recherche
impressionnante pour laquelle les auteurs ont bénéficié d’une cinquantaine
d’entretiens avec le chanteur, dont les citations se greffent continuellement
au texte relatant les détails de sa vie, de la naissance à aujourd’hui. Un très
bel hommage paru pour souligner le 75e anniversaire de Joseph Rouleau.
Dans notre
édition de mars, notre collaborateur Joseph K. So faisait une critique
élogieuse de l’autobiographie de la soprano américaine Renée Fleming The Inner
Voice: The Making of a Singer, parue chez Viking. C’est en effet avec
un très grand plaisir que j’en ai lu la traduction française : Une voix (Fayard,
356 p., 2005). Très bien écrit, le texte de la diva se lit comme un véritable
roman d’apprentissage, au long duquel on suit l’héroïne pas à pas depuis ses
premières intuitions musicales jusque dans les ligues majeures de l’opéra, en
passant par les hauts et les bas de son long apprentissage, ses réflexions sur
la technique vocale et les évocations des grandes voix qu’elle a côtoyées (et
côtoit toujours). Le talent de Madame Fleming pour l’écriture lui assurera sans
doute une deuxième carrière ! En attendant, la lecture de cette «
autobiographie de [s]a voix » vous donnera à coup sûr l’envie de la réentendre.
DVD
par
Réjean Beaucage
Maria
Callas : Living and Dying for Art and Love
Steve Cole, réalisateur
TDK – (71 min)
**** $$$$
Elle a
interprété le rôle de Tosca pour la première fois en 1942 et c’est aussi dans
ce rôle qu’elle chantait ses toutes dernières notes sur une scène d’opéra le 5
juillet 1965. Ce film, dont le titre s’inspire du texte de l’air célèbre de Tosca
« Vissi d’arte », entremêle les destins respectifs du personnage de l’opéra de
Puccini et de la célèbre chanteuse, dont les récits nous sont offerts par des
témoins qui ont connu aussi bien l’une que l’autre. On a donc droit à une
description de Tosca par, entre autres, Grace Bumbry, Placido Domingo,
Tito Gobbi et Franco Zeffirelli, de même qu’à une demi-biographie (la deuxième
moitié de sa vie) de la diva. Les fans, nombreux sans doute,
n’apprendront pas grand chose, mais ceux qui connaissent mal la vie de Callas y
découvriront de nombreux détails sur sa vie privée, sa façon de travailler et
son charisme. Nombreux documents d’archives, dont de rares extraits filmés
permettant de juger du talent de Maria Callas dans ce rôle qu’elle a tant
marqué.
CD
par
Isabelle Picard
La
voix baroque
L’époque
baroque a vu l’invention d’un nouveau style musical, qui mettait en scène une
voix soliste accompagnée d’une simple basse continue. La vedette principale en
était le texte, et l’idéal recherché, l’expression. Voici trois
sélections parmi les apports récents à la discographie de ce répertoire.
Commençons par la doyenne du groupe, la mezzo-soprano Anne Sofie von Otter («
Music for a While », Archiv Produktion 4775114), que nous pouvons entendre dans
un contexte intimiste, accompagnée par Jory Vinikour (clavecin et orgue
positif), Jakob Lindberg (théorbe, luth et guitare baroque) et Anders Ericson
(théorbe). Son récital se divise en deux grandes parties : on se trouve d’abord
en Italie (avec par exemple G. Caccini et C. Monteverdi), aux origines de la
monodie baroque. On fait ensuite le saut en Angleterre, en premier lieu avec
des mélodies de Purcell (1659–1695), puis avec John Dowland (1563–1626). Le
choix du répertoire italien est particulièrement intéressant et fait entendre
quelques airs peu enregistrés (dont un de Barbara Strozzi, une des rares
compositrices de l’époque). L’accompagnement instrumental est impeccable, comme
c’est d’ailleurs le cas pour ces trois disques, et von Otter use d’une grande
variété de timbres (trop grande, diront peut-être certains) pour s’approcher de
l’idéal d’expression. La jeune soprano allemande Annette Dasch («
Chansons baroques allemandes », Harmonia mundi HMN 911835) accorde également de
toute évidence une grande importance au texte et a choisi une approche
dramatique. Il s’agit pour elle d’un premier disque, qui laisse croire que son
nom sera à surveiller. Accompagnée par des membres de l’Akademie für Alte Musik
Berlin, elle propose un programme fascinant consacré aux racines de l’art vocal
baroque allemand (des noms qu’on voit peu, tels que H. Albert, J. Krieger, P.H.
Erlebach ou E. Kindermann), à une époque où les styles ancien et nouveau se
côtoient encore. On sent, particulièrement chez Heinrich Albert, l’influence de
la monodie italienne. Un manque du livret, cependant : ne pas avoir mis la
traduction des textes chantés. De ce côté-ci de l’Atlantique, le contre-ténor
Matthew White (« Disperato Amore », Analekta AN 2 9904), avec son ensemble Les
Voix baroques, présente un programme d’oeuvres d’Alessandro Scarlatti :
cantates (trois, parmi les quelques 600 composées par Scarlatti), motet et deux
sonates. L’approche de White est moins théâtrale, plus sobre. Ces cantates,
avec leur succession d’airs et de récitatifs, sont comme des opéras miniatures
où, encore une fois, le souci d’expression dramatique est bien présent. La
ligne mélodique est libre et les ornements de bon goût.
|
|